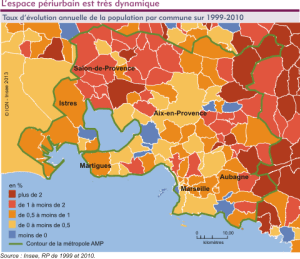Entre l’impopularité de l’exécutif et la nouvelle concurrence de son ancien « patron », Jean-Noël Guérini, la fédération socialiste des Bouches-du-Rhône et ses militants semblent déboussolés tandis que nombre d’élus jouent la carte de l’alliance avec le toujours président du conseil général. (Article publié dans l’Humanité du 23 février).
Lorsqu’un ancien ministre se déplace à Marseille et organise une rencontre avec les militants, 80 d’entre eux viennent l’écouter. Pas plus. « Et encore, on craignait moins », murmure un jeune cadre local alors que Benoît Hamon – c’est lui, l’ex-membre du gouvernement – débute son intervention qui durera près de trois quarts d’heure, entre considérations de philosophie politique – au demeurant, fort intéressantes – sur la liberté, l’égalité et long plaidoyer pro domo pour l’action du ministre de l’Education qu’il fut. Quand viennent les questions, la redescente est brutale. Sylvie: « On a l’impression que vous avez beaucoup cédé alors qu’à nous, militants, on nous demande de tenir.» Guillaume : « A quoi ça sert de militer au PS quand on n’arrive pas à changer le réel? »
Lorsque Jean-Noël Guérini, ex-membre du PS, président du conseil général, mis en examen à plusieurs reprises dans des affaires impliquant son frère, lance sa campagne pour les élections départementales avec le parti « ni de droite, ni de gauche » qu’il a créé en 2014, « La force du 13 », on trouve dans l’assistance, écoutant avec intérêt, des conseillers généraux socialistes sortants et candidats à leur succession.
Lorsqu’un texte appelle à un accord entre toutes les forces de gauche et la « Force du 13 », vingt-deux signatures de conseiller généraux sortants viennent s’y apposer. Quelques heures plus tard, un vingt-troisième franchit lui aussi le pas. Lors de la présentation de ses vœux à la presse, Guérini se permet même de le moquer : « Il ne devait plus avoir d’encre dans le stylo le jour même ».
Lorsque l’Humanité sollicite Frédéric Vigouroux, le 23e en question, vient cette réponse de son cabinet: « Désolé, mais il ne s’exprimera pas sur ce sujet avant les départementales ». Frédéric Vigouroux est également numéro 2 du PS départemental. Un cadre fédéral tente d’expliquer : « Vous savez, quand vous êtes en campagne, vous vous focalisez sur vos électeurs et vous n’avez pas envie d’apparaître dans la presse sur d’autres sujets. » Surtout, s’ils sont épineux.
Militants déboussolés voire déprimés, élus gênés aux entournures dès que l’on aborde la récurrente question des rapports à Jean-Noël Guérini ou carrément promoteurs d’une alliance : le PS bucco-rhodanien sait-il encore où il habite ?
Ajoutez à ce paysage déjà crevassé, des municipales catastrophiques (onze villes perdues, raclée à Marseille avec la perte de deux mairies de secteur dont l’une au profit du FN), des sénatoriales calamiteuses (seule Samia Ghali est élue) et une fronde antigouvernementale quasi-permanente, alimentée notamment par des élus socialistes dont certains ont quitté leur formation, contre la création d’une métropole. D’où la question : affaibli par le hollandisme, aspiré par le guérinisme, le PS des Bouches-du-Rhône n’est-il pas en voie d’effacement, d’inaction, on n’ose encore écrire : d’impuissance?
Il faut commencer par du numérique. Jean-David Ciot livre le chiffre de 4200 adhérents contre une moyenne de 6000 cartes remises ces dernières années. « On est tombé à l’étiage, reconnaît le secrétaire fédéral. Mais je pensais que ça serait pire, que l’on tomberait à 2000. Nous sommes convalescents suite à la mise en œuvre du contrat de rénovation, de la sortie de la tutelle et de l’échec des municipales à Marseille.» La ville d’Allauch, 20000 habitants, dirigée depuis 1975 par Roland Povinelli revendique, à elle seule, 600 cartes même si la direction fédérale place le curseur à 450… Une bonne vieille « baronnie » à l’ancienne dont le sociologue Philippe Juhem décryptait l’importance dans son article, daté de 2006, «La production notabiliaire du militantisme au Parti socialiste» : «Dans les Bouches-du-Rhône, neuf sections sur 95 réunissaient la moitié des effectifs de la fédération et trois d’entre elles, bénéficiant d’un maire socialiste (Allauch, Berre et Chateauneuf-les-Martigues), dépassaient 1 400 militants lors du Congrès de Dijon (2003, NDLR) – 1 200 au Mans – soit 23,3 % des effectifs de la fédération, alors que ces communes n’accueillaient que 2,8 % des électeurs du département et 3 % des électeurs y ayant voté en faveur de Lionel Jospin.» Le chercheur mettait en lumière « les effets de la maîtrise de l’institution municipale sur les effectifs du parti. » Hors l’«anomalie» Allauch, il y aurait donc environ 3750 adhérents.
Pour Pierre Orsatelli, porte-parole du collectif Renouveau PS 13, il faut diviser le chiffre officiel par deux, pas moins : 2200. 750 à Marseille, 350 à Allauch, et 1100 dans le reste du département, voilà son estimation. A Chateauneuf-les-Martigues, ex-« baronnie» tombée aux mains de l’UMP aux municipales de après plus de 70 ans de gestion socialiste, le trésorier, Marc Lopez, annonce une trentaine de cartes pour 13000 habitants. Lui-même ne cache pas que le moment est «assez dur, assez pénible» pour l’homme «aux valeurs de gauche» qu’il est, face à la politique gouvernementale.
L’impopularité de l’exécutif – pardon, «l’exercice du pouvoir», dans le parler euphémisé des socialistes locaux – frappe même ceux qui se montrent critiques. Ainsi les jeunes socialistes du département accusent également le coup : une cinquantaine d’adhérents contre une centaine. «Pas mal de déceptions sur pas mal de dossiers, on ne va pas se le cacher», reconnaît Fabio Chikhoune, le secrétaire départemental.
Mais s’il n’y avait que ce problème-là, le PS 13 vivrait avec moins de migraines. C’est son ancien «patron» qui lui en cause les plus sévères : Jean-Noël Guérini. Avec sa volonté d’imposer une métropole refusée par 110 des 119 maires du département, le gouvernement lui a offert, sur un plateau, un inespéré rôle de rassembleur. Aux sénatoriales, siphonnant à gauche, braconnant à droite, il a fait élire trois sénateurs : lui-même, le maire des Pennes-Mirabeau ayant quitté le PS et la maire « sans-étiquette », mais de droite, de Meyrargues. Et voilà que celui qui n’a laissé au PS qu’un seul siège de sénateur devient le porte-drapeau de nombre de conseillers généraux PS! Jean-David Ciot se veut, pourtant, ferme : « Il n’y aura pas d’accord avec Force du 13.» Dans la pratique, les choses semblent moins tranchées que les propos du principal responsable fédéral. Jean-Louis Canal, maire de Rousset et membre du bureau fédéral, sera candidat sous la bannière de… « Force du 13 ». Le sortant Hervé Chérubini préfère l’étiquette de la « majorité départementale ». Le PS ne présentera personne contre eux. D’autres conseillers généraux, dûment investis par le PS, ne font pas mystère de leur fidélité au président du conseil général. « Tous ceux qui ont signé l’appel à se ranger derrière Guérini n’auraient pas dû avoir l’investiture socialiste. Il n’y a pas d’accord départemental mais il y a un accord canton par canton», estime Pierre Orsatelli qui avait fait acte de candidature pour affronter Jean-Noël Guérini dans son fief du Panier. « Ma candidature a été « escamotée », assure-t-il. Dans ce canton, huit votants ont désigné le candidat PS contre Guérini. » Deux militants presque parfaitement inconnus.
Le 29 janvier, lors de l’inauguration du local de campagne de Guérini, qui fait binôme avec Lisette Narducci, ancienne socialiste membre de la majorité municipale de Jean-Claude Gaudin, plusieurs élus investis par le PS étaient présents. « Je leur ai dit qu’ils avaient fait une erreur d’aller chez Guérini », indique Jean-David Ciot, qui ne semble avoir d’autre pouvoir que celui de la parole. Sylvie Lyons, elle, est allée directement dire leur fait aux impétrants avant de se faire sortir manu militari. La militante a saisi la commission des conflits et commente : « Cette situation résulte aussi du bourbier dans lequel le parti socialiste marseillais refuse de sortir en posant des actes clairs.»
« Le parti est absorbé par la machine ». L’analyse est signée Cesare Mattina, sociologue qui met la dernière main à un ouvrage sur le clientélisme. « Mais le parti demeure important car il donne les investitures», ajoute-t-il. Voir. Christophe Masse a ainsi changé de remplaçante : Geneviève Tranchida en lieu et place de Zina Ghrib, désignée en décembre par les militants. Là encore, aucun « stop » de la rue Montgrand – siège du PS départemental – et silence de la rue Solférino. « Ils pensent –peut-être à raison – que Guérini est le mieux placé, si ce n’est le seul, à pouvoir empêcher la droite de s’emparer du conseil général », livre un observateur. Une « prime » aux sortants que Cesare Mattina décrypte ainsi : «Etant donné la dimension du corps électoral et le taux d’abstention attendu, les candidats de l’institution et leur équipe peuvent presque téléphoner à tous leurs électeurs nécessaires à leur victoire. L’élection cantonale est la plus clientélaire de toutes».
Guérini éventuellement réélu président. Et après ? « Je fais le pari qu’il y aura un après-Guérini. En 2017, il devra choisir entre le Sénat et le Conseil général et il choisira le premier», explique Jean-David Ciot. « Les procès de Guérini se dérouleront en pleine campagne électorale présidentielle… », anticipe Pierre Orsatelli. 2017, ou la conjonction annoncée du déclin du hollandisme et du guérinisme.